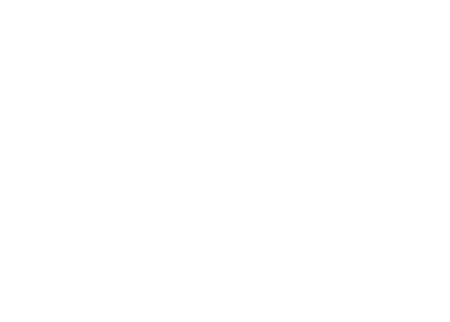Pointe noire de Pormenaz
Le sommet de la Pointe de Pormenaz vous offre un panorama à 360°. Pour y parvenir il faut d’abord trouver le départ de ce sentier non balisé depuis le lac. Le parcours est ensuite plus évident. On traverse des formations complexes mêlant calcaire et roche cristalline qui compose le massif des Aiguilles Rouges dont la Montagne de Pormenaz est une extrémité.
Document associé
- Téléchargerpdf
pointe-noire-de-pormenaz
Crédit : Points d'intérêts du parcours - Asters-CEN74
Les 34 patrimoines à découvrir

Le Dérochoir à l'automne - Julien Heuret - CEN 74  Histoire
HistoireVue sur le Dérochoir
Le Dérochoir est le résultat d’éboulements successifs. Le premier connu et documenté remonte à 1471. Le second et dernier, pour l’instant, est celui de 1751. Au pied de la falaise se trouve un immense cône d’éboulement qui forme une pente instable.
Ces différents éboulements ont permis d’avoir un passage pour franchir la barre des Fiz.
Panorama sur le Mont-Blanc depuis Plaine-Joux - Lucie Rousselot - CEN 74  Sommet
SommetLe mont Blanc avant l'alpinisme
Grand nombre d’alpinistes rêve de faire l’ascension du mont Blanc, le plus haut sommet d’Europe de l’ouest. Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Autrefois, la montagne inspirait à ses habitants peur et superstitions comme en témoignent les noms donnés aux sommets (mont Maudit, aiguilles du Diable…). Seuls bergers, chasseurs de chamois et cristalliers (extracteurs de cristaux de roches) fréquentaient ces zones hostiles.
Les premières ascensions ont été réalisées par des « étrangers » audacieux qui employèrent ces professionnels de la montagne pour les guider.
Vautour fauve en vol - Julien Heuret - CEN 74  Faune
FauneLe Vautour fauve
C’est un visiteur d’été en Haute-Savoie. L’espèce est monogame, c’est-à-dire que les couples sont unis pour la vie !
Cet oiseau vit en colonies de plus ou moins grandes tailles dont les plus proches sont situées dans le sud Vercors. Ce sont surtout les jeunes individus qui explorent de nouveaux territoires. Pour se nourrir, cet oiseau est également capable de couvrir des centaines de kilomètres grâce à sa pratique du vol à voile, sous réserve de conditions météorologiques favorables.

Grand corbeau en vol - Julien Heuret - CEN 74  Faune
FauneLe Grand corbeau
C’est le plus grand des passereaux et des corvidés !
Tour à tour craint ou vénéré, il est l’objet de mythes et de légendes dans de nombreuses cultures. Longtemps persécuté, il est aujourd’hui protégé. De la taille d’une buse, il se reconnaît notamment à sa queue en forme de losange et à son cri rauque. C’est un omnivore, c’est-à-dire qu’il se nourrit de charognes, d’œufs, d’oisillons ou de baies !
Les couples, unis pour la vie, s’adonnent à des parades nuptiales de haute voltige! Hormis l’homme, son seul prédateur est l’aigle royal.
Aigle royal en vol - Julien Heuret - CEN 74  Faune
FauneL'Aigle royal
Tout est exceptionnel chez lui !
Avec une envergure pouvant aller jusqu’à 2 mètres, il règne en couple sur un territoire équivalant à 10 000 terrains de foot !
Sa vue perçante et légendaire, détecte les mouvements d’une proie à plus de 1 km de distance. Ses yeux sont comme des loupes qui grossissent 6 à 8 fois ce qu’il perçoit et son champ de vision est de 240°.
Outre les couleurs, il est capable de déceler les ultra-violets, un atout de taille pour ce grand chasseur qui peut fondre sur sa proie en piqué à la vitesse de 350 km/h.
Mais nul n’est parfait : il rate 9 proies sur 10 !
Pic noir  Faune
FauneLe Pic noir
C’est le plus grand des 8 pics présents en France. A l’origine, espèce purement montagnarde , il se rencontre désormais aussi en plaine ! En effet, il s’adapte aussi bien aux forêts de feuillus que de résineux, dès lors qu’elles sont de grandes surfaces et qu’elles disposent de bois morts laissés sur place et de vieux arbres de gros diamètres.
Il se reconnaît aisément à son plumage entièrement noir égayé d’une tâche rouge vif, limitée à la nuque chez la femelle et plus étendue chez le mâle.
Gélinotte des bois - Julien Heuret - CEN 74  Faune
FauneLa Gélinotte des Bois
C’est la plus petite et la plus discrète des espèces de Galliformes de montagne.
Elle est bien moins connue que le Tétras-Lyre ou que le Lagopède alpin du fait de ses mœurs exclusivement forestières !
Mais elle est aussi importante d’un point de vue biologique et scientifique : c’est une espèce indicatrice des changements environnementaux. Ses exigences marquées en termes de végétation et de variété d’essences d’arbres la mettent en danger face à une mauvaise gestion forestière. C’est d’ailleurs l’une des principales causes de régression de l'espèce.
Sorbes - Julien Heuret - CEN 74  Flore
FloreLe Sorbier des Oiseleurs
C'est un petit arbre qui pousse en lisière des forêts. Ses fruits, appelés "sorbes", sont des baies rouges orangées qui sont très appréciées des grives et des merles.
Il est possible d'en faire de l’eau de vie, de la gelée ou de la confiture. A condition d'être cueillis avant maturité sous peine de toxicité!
Dans la réserve, le sorbier est étudié dans le cadre d'un programme de science participative destiné à mesurer l'impact du changement climatique en montagne.
Bouleaux en hiver - Julien Heuret - CEN 74  Flore
FloreLe Bouleau pubescent
Il existe quatre espèces de bouleau en Europe et celle qui est présente ici est le Bouleau pubescent. Sa sève et son écorce ont de nombreuses propriétés médicinales reconnues, on parle de drainage naturel, de remède contre les rhumatismes, la fatigue ou les allergies !
Dans la réserve, les bouleaux sont suivis dans le cadre du programme "Phénoclim" mis en oeuvre par le CREA et destiné à mesurer l'impact du changement climatique sur le cycle des végétaux.
Les Fiz depuis les Ayères - Julien Heuret - CEN 74  Histoire
HistoireLes Ayères
A l’origine, le terme « Ahier » provient du patois roman qui désigne l’Erable sycomore. Les termes “pierrières” et “roc” proviennent des nombreux blocs rocheux qui sont les témoins des éboulements du Dérochoir dont celui de 1751 qui tua 6 personnes et quelques animaux domestiques. Tous ces chalets étaient des chalets d’alpage à vocation agricole.
Maintenant ce sont des résidences secondaires.
Chalets d'Ayères - Julien Heuret - CEN 74  Architecture
ArchitectureArchitecture du chalet d’alpage
Certains des chalets d’alpage sont plus que centenaires.
La construction d’un bâtiment en altitude est fortement imprégnée de son environnement immédiat : pierres pour les murs, charpente sommaire en épicéa mais résistante aux conditions hivernales !
A l’origine, le toit était recouvert de tavaillons, une sorte de tuile en bois.
Ces bâtiments utilisés pour l’activité agricole à la belle saison étaient rudimentaires et servaient à abriter le berger et sa famille.

Chalets d'Ayères à l'automne - Julien Heuret - CEN 74  Pastoralisme
PastoralismeLe chalet d’alpage
Le chalet d’alpage est une petite bâtisse qui, regroupée avec d’autres, forme un petit hameau.
Ces constructions étaient à l’origine destinées à l’organisation de la vie agricole en montagne. Ces chalets étaient utilisés à la belle saison pour abriter les bergers et leur famille. Ils servaient aussi de salle de traite et de fabrication de fromage et autre produits laitiers.
Marmotte - Frank Miramand - CEN 74  Faune
FauneLe parler sifflé de la Marmotte
La Marmotte est le met préféré de l’Aigle royal et dans une moindre mesure, du Renard. Toujours vigilante, en position de « chandelle », elle surveille donc son environnement pour ne pas se faire prendre. Grâce à des yeux au champ de vision très large, à une ouïe et à un flair très performants, rien ne lui échappe. En cas d’alerte, elle prévient les autres par un cri d’alarme : très aigü et bref pour un danger venant du ciel, sifflé et répété pour un danger au sol. Et ce danger, c’est parfois vous !
La porte d'entrée de la réserve - Julien Heuret - CEN 74  Histoire
HistoireL'histoire de la réserve de Passy
Au cours des années 1970, la richesse des espaces naturels de Haute-Savoie est l’objet de toutes les convoitises. Face à l’appétit des promoteurs et aux nombreux projets d’aménagements touristiques, des voix s’élèvent. L’Etat Français prend alors la décision de créer 9 réserves naturelles nationales.
En 1974, la réserve naturelle nationales des Aiguilles Rouges voit le jour, puis c’est au tour de la réserve naturelle de Sixt-Fer à cheval/ Passy en 1977.
Entre ces deux espaces naturels protégés se trouve blottie une petite portion de territoire, qui deviendra la réserve naturelle de Passy en 1980.
Chien de protection des troupeaux - Geoffrey Garcel - CEN 74  Pastoralisme
PastoralismeChiens de protection des troupeaux
Ce sont des chiens de travail, leur présence est donc acceptée dans les réserves naturelles. Ils sont là pour défendre les moutons et brebis des attaques de grands prédateurs, comme le loup. Souvent de grande taille, ces chiens, qualifiés de "molossoïdes", dédient leur vie à la protection des troupeaux auxquels ils sont très attachés.
A l'approche du troupeau, il est important de rester attentif à leur comportement et de s'adapter, tout en respectant certaines consignes :
- Rester à distance du troupeau (le contourner si possible)
- Se signaler, à voix haute, aux troupeaux et aux chiens pour éviter de les surprendre
- Garder votre calme et éviter les gestes brusques, continuer à marcher sans courir. N’hésitez pas à leur parler doucement pour qu’ils s’habituent et acceptent votre présence.
- Eviter de regarder les chiens dans les yeux et mettre un objet entre vous et le chien.

Loup gris - Anne-Laure Martin  Faune
FauneLe Loup
Le loup est de retour en France, par ses propres moyens, depuis les années quatre-vingt-dix. Partie d’Italie, l’espèce a d’abord colonisé les Alpes du Sud, puis l’ensemble du territoire alpins.
Depuis l’été 2019, sa présence est avérée dans certaines des Réserves naturelles de Haute-Savoie d’où la présence de chiens de protection auprès de plusieurs troupeaux.
En effet, le loup est carnivore. Il se nourrit principalement d’animaux sauvages tels chamois ou chevreuils. Mais il peut aussi consommer des brebis ou des moutons, surtout quand les troupeaux ne sont pas gardés.
Pour ne pas gêner le travail des chiens, respectez les consignes !
Alpage de Moëde - Julien Heuret - CEN 74  Pastoralisme
PastoralismeL’alpage, un usage typiquement montagnard
L’alpage est une prairie d’altitude destinée à nourrir le bétail (vaches, moutons, chèvres…) à la belle saison, réservant les prés en vallée, plus accessibles, pour la fauche (coupe de l’herbe). L’herbe, une fois séchée deviendra du foin qui se conserve longtemps. Ce sera la nourriture des animaux pour l’hiver.
L’élevage de vaches produisant du lait était autrefois de tradition. Aujourd’hui, dans la Réserve naturelle de Passy, on trouve plutôt de grands troupeaux de moutons à viande.

Gentiane jaune - Julien Heuret - CEN 74  Flore
FloreLa Gentiane jaune
Cette grande plante vivace, de plus de 1m, se rencontre dans les prairies, les landes ou les clairières de forêts des étages montagnard et subalpin.
Utilisée en phytothérapie, il convient de ne pas la confondre avec le Vérâtre blanc, hautement toxique, à côté duquel elle pousse et à qui elle ressemble beaucoup !
Seules les fleurs ne se ressemblent pas. Celles de la Gentiane sont jaunes. En dehors des périodes de floraison, c’est surtout les feuilles qu’il faut regarder. Celles de la Gentiane sont face à face sur la tige, tandis que celles du Vérâtre sont alternées.
La cabane à Tintin et la pierre à l'ours - Julien Heuret - CEN 74  Pastoralisme
PastoralismeLa cabane à Tintin
Cette cabane, qui est plutôt un abri de berger, a été construite sous "la Pierre à l’Ours". Elle servait d’abri pour un berger qui jusque dans les années 60 gardait et menait son troupeau. En 1959, le berger avait 14 ans et gardait 2000 moutons. Mais où est l’ours ? Pour cela déplacez-vous sur le côté de la pierre et regardez bien, il est là !
Bouquetin mâle - Julien Heuret - CEN 74  Faune
FauneLe Bouquetin des Alpes
Cette espèce aujourd’hui protégée a bien failli disparaitre de l’arc alpin à la fin du XIXe siècle principalement du fait de la chasse ou du braconnage.
Différentes réintroductions successives dans toutes les Alpes ont permis d’augmenter les effectifs des populations bien que l’espèce reste encore aujourd’hui quasi-menacée.
Dans la réserve, les bouquetins font l’objet d'un suivi destiné à veiller sur leur état de santé ou à améliorer la gestion des effectifs de l’espèce.
Gypaète barbu adulte - Julien Heuret - CEN 74  Faune
FauneLe Gypaète barbu
Avec une envergure de près de 3 mètres, un corps orange vif, un œil cerclé de rouge, des plumes noires de part et d’autre du bec formant une barbichette, il n’en fallait pas plus au Gypaète pour effrayer les populations alpines d’autrefois qui voyaient en lui l’expression du diable !
Exterminé des Alpes au début du 20e siècle, cet oiseau inoffensif et majestueux est de retour dans le ciel alpin grâce au plus grand programme de réintroduction animal initié il y a 30 ans en Europe.
Les bâtiments du Refuge de Moëde-Anterne - Julien Heuret - CEN 74  Refuge
RefugeLe refuge de Moëde-Anterne
Il est depuis longtemps la propriété de la Famille Didier. A l’origine, depuis 1946, le refuge était dans l’ancienne bâtisse qui existe toujours ! En 1994, le nouveau refuge est construit. C’est aujourd’hui le plus gros refuge sur le tour des Fiz et sur le tour des Aiguilles Rouges. Il est aussi situé sur l’itinéraire du GR5 et de la Grande Traversée des Alpes.
Laouchet pendant l'été - Julien Heuret - CEN 74  Lac
LacLes Laouchets de Pormenaz
Ces petites étendues d’eau peu profondes sont appelées à tort des lacs.
Ici on les appelle des “laouchets”, ce qui signifie “petites pièces d’eau”. Peu profondes, ces étendues d’eau abritent une espèce rare et protégée, le sparganium ou Rubanier à feuilles étroites, ainsi qu’une biodiversité importante. A terme, ces laouchets vont se combler et devenir des tourbières.
Floraison du Rubanier à feuilles étroites - Julien Heuret - CEN 74  Flore
FloreLe rubanier à feuilles étroites
Ce que l’on voit à la surface du Laouchet, n’est pas une algue mais une plante à fleurs dont les longues feuilles étroites, telles des rubans aux reflets changeants, flottent sur l’eau. Le Rubanier vit dans les eaux calmes, froides et peu profondes des lacs et étangs de montagne. Il possède sous l’eau, des tiges remplies de réserves nutritives : les rhizomes.
Avec le comblement en terre du Laouchet, la population de Rubaniers s’étend, accentuant le phénomène en apportant chaque hiver ses tiges et ses feuilles fanées
Les tourbières de Pormenaz en fleurs - Julien Heuret - CEN 74  Archéologie
ArchéologieLes tourbières
Probablement des petites étendues d’eau dans un passé lointain. Ici, suite à leur comblement, une tourbière s’est formée. Des fouilles archéologiques sur le pourtour, ont mis en évidence des traces d’occupation humaine remontant jusqu’à l’âge du Bronze (-2200 ans av. J.-C.), l’âge du Fer (-800 ans av. J.-C.) et l’Antiquité (-52 ans av. J.-C.). C’est grâce aux feux faits par les hommes et à leur datation au carbone 14 que l’on a pu remonter le temps.
Suivi scientifique de Lac sentinelle à Pormenaz - Carole Birck - CEN 74  Savoir-faire
Savoir-faireLac sentinelle
Milieux emblématiques des montagnes, les lacs d'altitude sont des écosystèmes fragiles. Les conditions climatiques extrêmes auxquelles ils sont soumis, engendrent un fonctionnement spécifique mal connu. Les études récentes nuancent leur image de nature préservée. Le programme « Lacs sentinelles », mis en oeuvre par le gestionnaire de la réserve, a pour ambition de coordonner la recherche et l’observation des lacs d'altitude à l'échelle alpine. L'enjeu est d'améliorer la compréhension du fonctionnement et des menaces qui pèsent sur ces lacs, afin de mieux les préserver. Le Lac de Pormenaz fait ainsi partie des lacs étudiés.
Les Fiz avec reflets - Julien Heuret - CEN 74  Géologie
GéologieLa barre des Fiz, une falaise venue de la mer
Cette impressionnante paroi s’est créée dans une mer tropicale. Au cours des millénaires, les organismes marins aux coquilles ou aux squelettes de calcaire se sont déposés au fond, après leur mort. En s’ajoutant aux débris de roches usées, ils ont formé des couches différentes selon les époques.
Lorsque le Mont-Blanc s’est soulevé, cet empilement de couches s’est plissé et cassé. L’érosion a alors dégagé cette magnifique paroi dont les fossiles témoignent de son origine océanique.

Mine à Pormenaz - Julien Heuret - CEN 74  Histoire
HistoireLes mines de Pormenaz
La montagne de Pormenaz est parsemée de mines qui ont été exploitées dès l’époque gallo-romaine et jusqu’au XIIème siècle. De ces mines étaient extraits du plomb argentifère, des pyrites aurifère et cuivreuse et de l’antimoine. C’est surtout le plomb et l’argent qui étaient recherchés. Environ 125 kg de plomb et 1 kg d’argent étaient extrait d’une tonne de minerai.
Julien Heuret - CEN 74  Faune
FauneLes odonates
Les odonates, plus communément appelées libellules, sont des insectes.
Elles connaissent deux stades dans leur vie: une phase “larvaire“ qui est aquatique suivie d’une phase terrestre, qui représente l'âge adulte.
Les libellules sont des prédateurs: ce sont des carnivores se nourrissant de différents types de proies en fonction de leur stade. Elles mangent ainsi d'autres insectes.
Leur répartition est fortement liée aux conditions climatiques et tout changement impacte fortement leur présence. La destruction de leur habitat, les zones humides, est l’une des principales menaces qui pèsent sur les libellules.
@NicolasPerrouchet  Faune
FauneLa Couleuvre à collier
Semi-aquatique, elle fréquente surtout des zones humides mais aussi des milieux plus secs partout où elle peut chasser ses proies principales que sont les amphibiens (grenouilles, crapauds, salamandres ou tritons).
C’est une espèce protégée, comme tous les reptiles !
Elle se reconnait à sa pupille ronde, à sa couleur gris olive et son double collier noir et blanc ou jaune. Son autre particularité : quand elle se sent en danger, elle crache un liquide nauséabond puis elle fait la morte, dévoilant alors son ventre bicolore en motif de clavier de piano !
Amplexus crapaud - Julien Heuret - CEN 74  Faune
FauneLe Crapaud commun
Le baiser au crapaud le transformant en prince charmant est un mythe ! Il ne faut d’ailleurs pas toucher cette espèce protégée, sensible aux maladies que l’homme peut lui transmettre.
Par contre, regardez-le dans les yeux pour voir sa pupille horizontale et son iris orangé. Vous pourrez également observer ses glandes parotoïdes à l’arrière de sa tête. Elles lui servent à excréter un venin, la “bufotoxine” destiné à éloigner tout éventuel prédateur.
Le Crapaud est une espèce différente de la grenouille, il vit en grande partie en forêt, hors de l’eau, la rejoignant seulement pour s’y reproduire !
@JLFouquer  Faune
FauneLe Vairon et le Chevesne
Le Vairon est très commun dans les eaux très oxygénées. Sa présence dans les lacs d’altitude est dûe à la pratique de la pêche de la truite. En effet il est utilisé comme appâts par les pêcheurs, ce qui a permis sa colonisation des lacs de montagne.
Le Chevesne est un poisson assez gros, très répandu en France. C’est un omnivore, c'est à dire qu'il mange de tout. Dans nombre de pays européens, notamment à l'Est, il a un intérêt culinaire important.
Le Mont-Blanc depuis une prairie fleurie de Plaine-Joux - Lucie Rousselot - CEN 74  Histoire
HistoireL'histoire de Plaine-Joux
Forêt puis alpage, Plaine-Joux n’a pas toujours été une station de ski. Son nom qui signifierait « forêt sur un espace plat » en témoigne.
Dès les années 1930, les habitants de Passy s’adonnaient déjà au ski sur ce site au panorama exceptionnel. C’est vers 1965 qu’il devient officiellement une station de ski communale. Aujourd’hui encore Plaine-Joux reste, été comme hiver, une station prisée des familles pour la pratique du ski, de la randonnée, du parapente… et de la contemplation.

Panorama Mont Blanc - Julien Heuret - CEN 74  Géologie
GéologieLe mont Blanc
Sous la neige et les glaciers, deux roches principales forment le Massif du Mont-Blanc : les arêtes acérées et les plus hauts sommets sont en granite, très dur (de gauche droite : aiguilles de Chamonix dont l’aiguille du Midi, mont Blanc du Tacul, mont Maudit, sommet du mont Blanc) tandis que les parties plus rondes, car plus tendres, sont en gneiss (de gauche à droite : dôme du Goûter, aiguille du Goûter, aiguille de Bionnassay….).
Ces deux roches dites cristallines, proviennent du cœur de la Terre en fusion.
Description
- Prendre la route goudronnée qui passe devant le restaurant "Lou Pacheran". Direction refuge de Moëde-Anterne, Col et Lac d'Anterne.
- Prendre la piste en montant direction refuge de Moëde-Anterne, Col et Lac d'Anterne. Balise 102.
- A la table d'orientation, continuer tout droit sur la piste en direction du refuge de Moëde-Anterne, Col et Lac d'Anterne. Balise 103.
- Continuer sur la piste en direction du refuge de Moëde-Anterne, Col et Lac d'Anterne.
- Continuer tout droit sur la piste en direction des Ayères des Pierrières, du Col et Lac d'Anterne. Balise 16.
- Traverser le hameau des Ayères des Pierrières.
- Prendre à gauche la piste en direction du refuge de Moëde-Anterne, Col et Lac d'Anterne. Balise 121.
- Au bassin, soit rester sur la piste qui monte à gauche, soit prendre le sentier tout droit. Attention, sentier aérien ! Balise 134.
- Rester sur la piste en direction du refuge de Moëde-Anterne, Col d'Anterne.
- Rester sur la piste en direction du refuge de Moëde-Anterne, Lac de Pormenaz.
- Au refuge, prendre la piste en direction du Lac de Pormenaz. Balise 124.
- Prendre le sentier tout droit en direction du Lac de Pormenaz. Balise 125.
- Prendre à gauche le sentier en direction du Lac de Pormenaz. Balise 99.
- Prendre le sentier à gauche le long du lac de Pormenaz en direction des chalets de Pormenaz, Pointe noire de Pormenaz. Balise 127.
- A la balise 128. Prendre direction Pointe Noire de Pormenaz. Suivre le sentier qui est balisé avec des piquets à bout jaune.
- Pour le retour, redescendre jusqu'au point 13 - balise 99. Soit prendre la direction des Chalets du Souay par les Argentières. Chemin aérien. Soit prendre la direction du refuge de Moëde-Anterne et redescendre jusqu'aux Chalets d'Ayères. Puis direction Le Châtelet d'Ayères - Le Lac Vert.
- Balise 97. Prendre la direction le Châtelet d'Ayères - Lac Vert.
- Balise 95. Direction du Lac Vert.
- Prendre la direction de Plaine Joux. Par la route goudronnée. Balise 94.
- Balise 93. Prendre le chemin à droite direction Plaine Joux.
- Prendre direction Plaine Joux à gauche par le route.
- Départ : Maison de la Réserve naturelle de Passy
- Arrivée : Maison de la Réserve naturelle de Passy
- Communes traversées : Passy et Servoz
Profil altimétrique
Zones de sensibilité environnementale
Réserve naturelle nationale de Sixt-Fer-à-Cheval-Passy

Pensez à rester sur les sentiers.
- Domaines d'activités concernés :
- Aerien, Manifestation sportive, Terrestre, Vertical
- Contact :
- Asters - Conservatoire d'espaces naturels de Haute Savoie
contact@cen-haute-savoie.org
Recommandations
Soyez prudent et prévoyant lors de la randonnée. Asters, CEN 74 n'est pas tenu responsable en cas d'accident ou de désagrément quelconque survenu sur ce circuit.
Transport
Accès routiers et parkings
Accéder à la station de Passy Plaine Joux par la route D43.
Parking à l'entrée de la station.
Ligne de bus L85 (SAT Mont-Blanc).
Stationnement :
Signaler un problème ou une erreur
Vous avez repéré une erreur sur cette page ou constaté un problème lors de votre randonnée, signalez-les nous ici :